Escales dans les quarantièmes
Après la tempête, le calme. Le lendemain au petit matin, nous apercevons la côte. Brumeuse et pluvieuse en mer, aride à terre. Une terre ocre, sans arbres ni végétation visible. Un paysage désertique, lunaire. Ou plutôt martien aux vues des couleurs de la roche. Notre abri après ces 3,5 jours en mer se nomme Caleta Sara, une toute petite crique semble-t-il protégée des vagues et du vent. Le changement est radical. Nous nous enfonçons dans la crique minuscule, découvrons une petite cabane. De nombreux guanacos (lamas argentins) en train de brouter lèvent les yeux et la tête, nous regardent arriver avec curiosité. Le kelp, ces algues des hautes latitudes sont tout autour de nous et menacent de se prendre dans l’hélice ou les safrans. La concentration est totale, nous mouillons l’ancre, j’éteins le moteur. On savoure le silence, et on se laisse porter par l’émerveillement d’arriver dans ce qui semble être un nouveau monde.
Rapidement, l’annexe est mise à l’eau et on se dirige vers la cabane, qui est en fait un club nautique. Une unique bouée permet l’amarrage d’un zodiac, et nous apercevons plus loin une poignée de kayaks. Les installations du Club consistent en un bâtiment carré très simple mais très chaleureux à l’intérieur, qui fait office de cantine. Trois containers de cargo sont éparpillés et aménagés en dortoirs pour les randonneurs. En discutant un peu, les personnes présentes nous proposent de partager leur repas, dont des empanadas à la langouste, délicieuses.
Nous en profitons pour marcher dans les alentours, dans ces plaines arides, au milieu des guanacos et même d’un tatou, animal au look bien préhistorique ! Nous passons la nuit au mouillage, nuit très calme, sans vent, et partons au petit matin vers l’Isla Leones, recommandée pour ses colonies de lions de mer.
La petite navigation de deux heures se passe très bien, sans vent, au moteur, et arrivons au mouillage sur l’île. L’ile est à l’image du continent : plate, déserte, rocheuse, sans végétation visible. Le bruit au loin, ainsi que l’odeur, nous indique rapidement l’emplacement des colonies, et nous apercevons même des colonies de pingouins de Magellan. Nous connaissons déjà un peu ces pingouins, car en mer ils nagent souvent autour du bateau depuis notre arrivée dans les 40èmes. Même en pleine mer nous en avons croisés ! Au début on aurait dit des canards posés sur l’eau, mais lorsqu’on s’approchait trop ils plongeaient et réapparaissaient 20 ou 50 mètres plus loin, dans une direction jamais prévisible.
Un peu après notre arrivée, nous avons déjà de la visite au bateau : une dizaine de lions de mer nagent autour de nous, faisant des pirouettes et nous fixant bien curieusement ! Ils resteront un peu avec nous le temps du repas et de mettre l’annexe à l’eau pour débarquer sur l’ile pour les voir de plus près. Débarquement d’ailleurs mémorable, car il n’aura pas lieu ! Annexe à l’eau, nous nous dirigeons vers la côte. Nous choisissons la plage principale et laissons la petite plage secondaire sur notre droite. La colonie est impressionnante, et fort bruyante ! Les quelques pingouins perdus au milieu semblent minuscules face à l’imposante stature des plus gros spécimens de lions de mer au cou énorme. La plage est complètement recouverte, on a du mal à viser un endroit libre. On choisit notre point d’atterrissage, une bande de peut être 1m de large seulement, lorsque tout à coup, une trentaine de lions de mer sautent à l’eau et foncent vers nous ! Spectacle impressionnant ! Au début, je me demande si c’est un accueil curieux ou une tentative de défense du territoire. Et bien je serai vite fixé : à une vingtaine de mètres de la plage, ils commencent à nous éclabousser à grand coup de palmes, créant des immenses jets d’eau et leur attitude ne semble pas du tout ni curieuse ni accueillante : ils nous attaquent !! Demi tour immédiat, le Torqueedo à fond (notre fidèle moteur électrique), direction l’autre petite plage moins peuplée. La meute de lions de mer nous suit et semble vouloir en découdre et le changement de direction ne semble pas beaucoup les calmer. Aux abords de la deuxième plage, la petite troupe qui nous pistait reprend encore de l’ardeur et commence à montrer les crocs : on comprend vite pourquoi on les appelle des lions de mer ! Avec notre escorte musclée, la seconde plage semble tout aussi inaccessible. Alors penauds, nous rentrons au bateau, qui semble cette fois ci apaiser nos convoyeurs, puis appareillage pour quitter le mouillage et rejoindre Caleta Horno. Que d’émotions ! Une fois de plus, je suis émerveillé par le sentiment de ne pas me sentir chez moi, ou de ne pas être le bienvenu. Fascinante remise en question de l’omniprésence humaine.
Ces « claques », la tempête, l’attaque des lions de mer, l’immensité désertique, me font prendre conscience à quel point en temps qu’humain, ou du moins de blanc occidental des villes du 21ème siècle, nous nous sommes appropriés la planète et pensons être légitimement chez nous où que ce soit, en suffisant de prétexter l’incroyable mot clé passe partout qu’est le « voyage ». Mais comme ça fait du bien ! J’aime profondément cette sensation de ne pas me sentir le plus grand prédateur, que le monde n’est pas un jardin apprivoisé ou pire colonisé, j’aime ne pas me sentir le bienvenu juste par le motif que je suis venu. J’aime ce malaise face à la nature, à la puissance de l’animal, qui me rappelle comme je suis petit, insignifiant et désarmé, mais terriblement chanceux d’être en vie et d’admirer tout ça.
J’ai eu beau trier mes ordures et manger bio, légumes locaux de saison et bières artisanales, pensé et réfléchi à mon impact carbone quand je prenais l’avion, j’ai eu beau envoyer chier tous ces principes avec le V8 de ma Mustang, et bien rien, mais rien n’est comparable au sentiment d’être seul, vraiment seul face à la nature. Dans les deux sens. Le Julian écolo et le Julian pollueur sont à mettre dans le même panier : complètement déconnecté de la réalité, comme enfermé dans la bulle confortable et routinière offerte par la société occidentale et les diplômes, la promesse de l’emploi, la recherche de ce somptueux sentiment de réussite et d’autosatisfaction de pouvoir sortir le week-end sans réfléchir plus que ça, en choisissant son resto sur Tripadvisor. J’ai depuis ces événements (bien que cela ait commencé en profondeur bien plus tôt) un sentiment de distance total par rapport à mon passé qui me semble si loin et si déconnecté de la vie que je mène aujourd’hui. Je réfléchis souvent à mon existence sur terre, au sens que je veux donner à ma vie, et à l’importance des choses à vivre, ressentir, découvrir avant de mourir. Et lorsque je repense à mon passé, je vois un homme avec les pieds qui ne touchent pas le sol, enfermé, cloisonné, contraint à se réjouir de petites victoires qui s’achètent au prix de semaines interminables à ne pas avoir le temps, à espérer le lendemain, le prochain week-end, les vacances, la retraite, la mort. Ces victoires sonnent comme les récompenses inscrites sur une grille définie à l’avance et identique pour tout le monde, comme un playmobile dans une boite à chaussures. A mes yeux l’existence est infinie, elle ne peut pas s’écrire dans une grille ou tenir dans une boite.
Que le système corresponde à des gens, c’est très bien. Que l’on puisse être heureux au sein de ce système, je m’en réjouis. Que chacun s’acclimate, se contente, s’épanouisse, rejette sans agir ou s’approprie ces règles selon les cas, je ne le remets absolument pas en question et ne le juge pas : tant mieux, vivez pleinement votre existence ! Mais moi, cela ne m’a jamais rendu heureux, et de découvrir le sentiment d’isolement me fait comprendre à quel point j’ai souffert pour comprendre puis accepter les règles du système, puis souffert pour m’en détacher, avant de ressentir pleinement l’essence de la vie que j’ai toujours rêvée de mener, seul perdu dans l’immensité des espaces, loin de l’omniprésence, du nivelage, de la sécurisation. A mes yeux, l’homme n’est qu’un animal parmi d’autres, mais avec la chance incroyable d’être conscient de son existence, d’avoir pu découvrir l’immensité du monde et de l’espace intersidéral. L’homme a le fardeau de porter en lui la conscience de cet infini, et peut être que toutes ces règles, ce système que j’aime tant décrier sont la seule protection que l’homme, petit être faible face à la nature, a su ériger pour se rassurer de cette peur du vide. Alors que justement, nous sommes les enfants de cet infini, c’est notre monde, notre environnement à nous, sinon pourquoi alors le percevrions-nous ? Pourquoi ne pas l’embrasser plutôt que de vouloir à tout prix le cloisonner ? Ce sentiment de paix que je ressens, de bien être, de repos, cette sensation d’être à ma place au milieu de cette nature à la puissance surhumaine, au fond, n’est peut-être que le résultat de l’abattage des murs, et une fois la peur envolée et l’horizon dégagé, la découverte que l’infini maintenant réconfortant est mon monde. L’infini se transforme alors en liberté…
Pour se rendre à Horno, j’utilise la voile du flemmard : le génois seul. C’est ma voilure préférée. Flemme de monter la grand voile pour trente minutes, un peu de vent par le travers ou le grand largue et c’est parti ! J’ouvre le taquet, le génois se déroule tout seul, se règle en deux coups de manivelle. 15 noeuds de vent, 5 noeuds sur l’eau, que demander de plus ? Je me souviens d’un catamaran qui partait en tour du monde que j’avais croisé à Cherbourg, lorsque j’étais au port le bateau fraichement livré. J’avais un peu discuté avec son propriétaire. J’étais surpris, il n’avait pas de grand voile mais uniquement trois voiles d’avant sur enrouleur : une petite, une moyenne et une grande. Cet homme est un héros des océans qui à poussé la flemme encore plus loin que moi.
L’entrée est majestueuse, j’en suis bouche bée. Le bateau entre dans une passe à peine distinguable tant la roche est identique partout. Heureusement la carte électronique semble juste. Puis on se faufile entre les falaises, l’eau est verte turquoise sublime, nous avons l’impression de rentrer en voilier dans la montagne. Puis le passage s’élargit dans une sorte de petit lac, et permet de mouiller pas plus de trois voiliers. Nous sommes seuls et nous nous mettons en plein milieu. Le vent s’engouffre dans cette vallée et accélère un peu, et la météo annonce que le vent va forcir pendant la nuit. Il est grand temps de sortir pour la première fois ces fameuses amarres bleues de 100m achetées pour les mouillages en Patagonie et aller en porter une à terre pour sécuriser l’ancre qui dérape un peu (les fonds n’accrochent pas très bien). C’est un peu l’escalade, les roches sont abruptes et glissent car nous sommes à marée basse. Je passe une chaine autour d’un rocher, y fixe l’amarre. C’est bon, cela semble tenir !
On profite de l’après midi pour débarquer à terre et se promener sur les falaises. Immensité désertique à perte du vue, quelques guanacos qui courent dans la pampa. La vue est à couper le souffle, nous restons sans voix. Le vent accéléré par les falaises rend sur les sommets la marche difficile, on glisse de temps en temps, mais on arrive tout de même à s’approcher des bords et tenter quelques acrobaties pour aller voir les falaises de plus près.
Cette immensité me parle terriblement. Cet isolement, cette solitude, ce changement d’échelle soudain entre la ville bien cadrée et les plaines à perte de vue, royaume des guanacos qui parcourent une centaine de mètres en quelques instants là où il nous faut bien 15 minutes pour grimper les obstacles. Je suis fasciné, émerveillé, appelé par ces espaces infinis, par cette absence de civilisation et de traces humaines.
Notre nuit à Horno se passe bien, le vent monte à 30 noeuds mais le dispositif ancre + amarre à terre fonctionne bien. Nous partons au petit matin (oui, enfin vers les 11 heures) direction Isla Tova. Paysage désertique, végétation peu présente, tout semble désert. Nous mouillons dans une grande baie et le bateau semble tout petit au milieu de ces étendues. Cela change de son écrin de pierre à Horno ! Nous débarquons à terre, et là, faisons une rencontre surprenante mais depuis longtemps espérée et attendue : dans les buissons à ras du sol de grands trous creusés, et dans chaque trou ou presque… des pingouins ! Nos regards s’ajustent et l’ile se transforme soudainement en champs de petits buissons pratiquement tous habités. Notre présence déplace quelques individus qui forment vite des groupes qui marchent plus loin. Les récalcitrants à la balade, surtout les petits et les parents en charge de les protéger, restent bien cachés dans leurs terriers à nous observer. Lorsque l’on s’approche trop près, ils oscillent la tête de gauche à droite dans de grands mouvements sensés effrayer l’ennemi. Nous, on trouve ça mignon ! Il y en a partout. On passe de longues heures à déambuler sur l’île, comme des gamins, à prendre cent fois la même photo d’un pingouin sous un buisson : parfois il y en a un, parfois deux, parfois avec un petit. Ce sont des pingouins de Magellan, ou devrais-je dire manchots pour être plus exact car ils ne volent pas. L’île est survolée par les oiseaux, dont quelques rapaces, des lièvres se terrent eux aussi dans les buissons, nous rencontrerons de nouveau un tatou, et tout ce beau monde semble mener une vie bien paisible avec une cohabitation heureuse que nous venons à peine troubler.
De retour au bateau, nous préparons notre départ pour Puerto Deseado, à une trentaine d’heures de navigation. La météo est bonne et nous comptons en profiter. Nous quittons le mouillage au moteur dans le calme absolu, contournons l’île, et prenons petit à petit la route du large.
Une heure, deux heures, trois heures de moteur, et je retrouve les sensations de navigation au tout début de mon voyage, au large de l’Espagne et du Maroc. Car oui, depuis j’étais perpétuellement bercé par les alizés, ces vents établis qui soufflent en permanence dans la même direction, avec relativement la même force. J’avais oublié que le vent pouvait tomber, délivrant de longues heures sur mer plate au moteur. C’est un avantage des régions dans le système des dépressions : oui, il y a des coups de vents, mais il y a aussi des calmes plats !
J’avoue, retrouver ces navigations au moteur me fait du bien et me berce dans mes anciens souvenirs. Cela permet de relâcher un peu la pression, la vie à bord s’installe doucement comme au mouillage, l’attention se porte sur la nature, la mer, la contemplation, l’horizon à perte de vue, l’étrave du bateau qui en séparant la mer en deux crée deux petites vaguelettes dans les reflets du ciel et des baleines. Quoi ?! Une baleine ?? Perdu dans notre contemplation, au loin nous apercevons un geyser sortir de l’eau. Indescriptible. Tribord toute, direction le geyser ! Il ne faudrait pas louper notre première baleine ! Je réduis un peu le régime du moteur, le bateau avance à pas de velours dans une mer miroir, et puis soudainement, sans un bruit ou presque, à seulement quelques mètres de nous, le dos puis l’aileron d’une baleine. Le temps s’est complètement arrêté. Au loin, nous apercevons un autre geyser, alors nous nous dirigeons lentement. Puis un autre apparait derrière nous, un à droite, un plus au loin. Nous nous arrêtons, le soleil est maintenant bien bas sur l’horizon, le ciel en train de s’enflammer. La nuit commence à s’établir sur la moitié de l’horizon, parsemé de quelques nuages roses, et de l’autre côté le soleil flamboyant à quelques minutes de disparaitre, inonde le ciel d’un oranger profond. Autour de nous, des baleines à perte de vue. Nous ne distinguons que les geysers et entendons leur respiration, à 360 degrés autour du bateau, à toutes les distances. Nous sommes dans un champ de baleines, nous les entendons respirer au loin, le ciel s’enflamme complètement dans son dégradé rose-orangé avec une pleine lune venant ponctuer l’instant de son regard. Moment magique, qui semble éternel, perdu au milieu de l’océan dans le royaume des baleines que nous n’intéressons même pas, mais qui nous émerveillent de leur présence. Entendre la mer respirer, quelle beauté !
Instant majestueux qui nous plonge dans la nuit, la pleine lune et les étoiles. Le vent monte petit à petit, le moteur troqué par les voiles. Cap sur Deseado, dernière escale avant le grand saut dans les 50èmes hurlants, qui sera notre terrain de jeu pour les prochains mois. Nous ne savons pas encore si nous irons à Ushuaia directement ou passerons par les îles Falkland (Malouines). La fenêtre météo nous le dira, ou plutôt le courage d’affronter ou pas ces îles venteuses balayées tous les trois jours par les coups de vents… nous verrons bien.





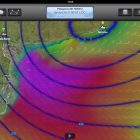

























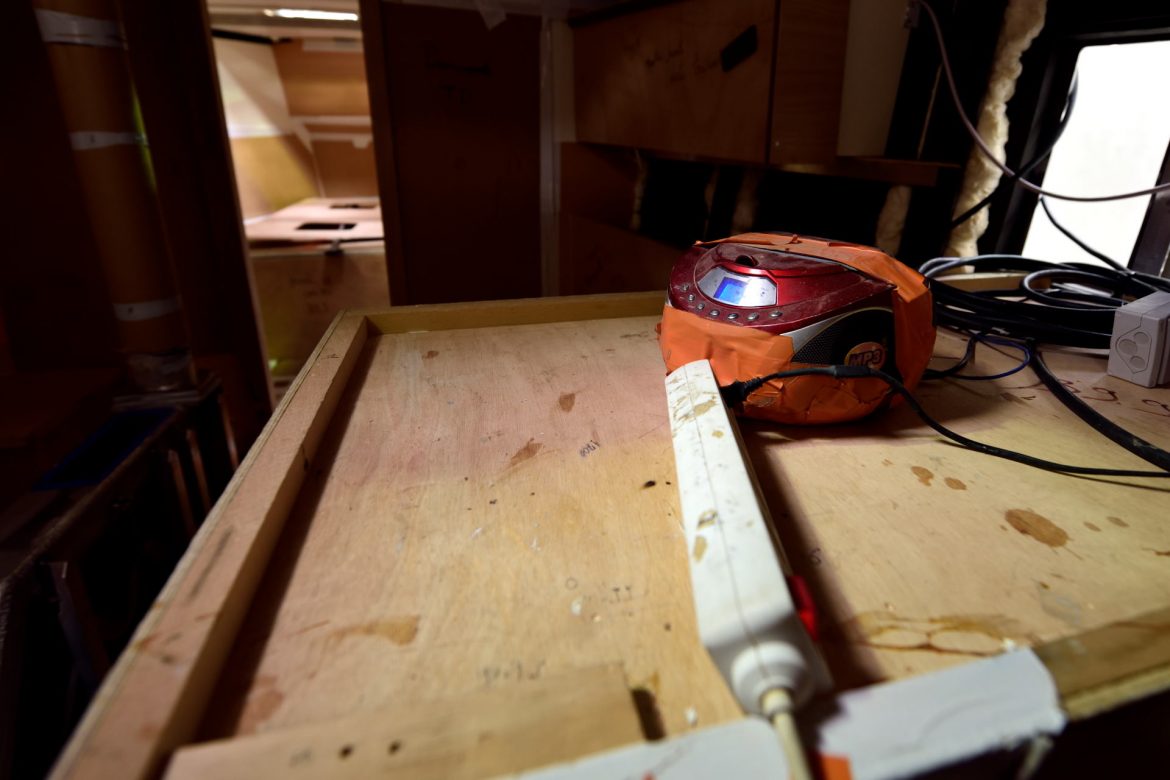





Roman
25 avril 2017Ciao le grand!
Bcp de plaisirs à te lire!
J’ai bien résonné sur l’idée de la signification de l’importance ou non de l’homme ainsi que « notre » mission.
La nature, les planètes, l’espace est infiniment plus grand et plus puissant que l’homme et pourtant, l’homme pense qu’il « maîtrise ».
Il maîtrise rien et encore moins sa destinée… si un jour une météorite, percute la petite planète bleue, toutes les théories et toutes les considérations, et tous
nos petits problèmes à 2 balles, envolés…
J’adore le tournant que ta vie à pris et je te soutient à vie 😉
Ou bieeeeeennnnnnn!